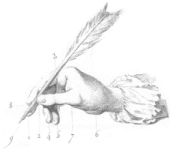Moteur actif Cléphi | courrier - contacter - Philia - |
|
Vous êtes ici : |
La messagerie de Philia édition originale 16-03-2003 actualisée le 12-05-2008 |
|
28 et 29/02/2008, 01 à 04/03/2008 |
|
|
|
28/02/2008 : Cette demande de Endlessly, qui est en classe terminale : « Bonjour, j'ai une leçon sur l'art à faire, et j'ai déjà un plan : I – Le goût et le génie
J'ai déjà quelques idées pour mes parties, mais pourriez-vous m'aider à les compléter, notamment avec des notions importantes, citations, etc. ? Merci d'avance. » |
|
=> 29/02/08 : Bonjour endlessly. Pour ne rien vous cacher, votre demande me paraît assez étrange : n'est-ce pas habituellement le professeur qui conçoit les leçons ? Quoi qu'il en soit, il paraît difficile, au seul vu de votre plan, de deviner quelle en est la "logique". Il faudrait au moins proposer une introduction générale présentant le problème que vous estimez être au coeur de la notion d'art, ce qui permettrait de comprendre la démarche adoptée dans le plan. Du moins est-ce ainsi que procèdent les professeurs quand ils préparent leurs cours... Un plan ne doit pas simplement faire se succéder des approches diverses ; il doit être ordonné, c'st-à-dire suivre un fil conducteur, un peu comme dans une dissertation. Ici, au contraire, on peine à saisir le "fil". Par exemple, si l'intention de l'artiste n'est pas d'imiter la nature (votre II), ne faut-il pas le considérer comme un créateur, voire un génie (votre I) ? Merci de me recontacter avec plus de précisions. Avec mes amitiés. Philia. |
|
|
Endlessly le 01/03/08 : « Bonjour philia ! En réponse à vos questions, en effet mon professeur de philosophie m'a demandé de rédiger une leçon sur l'art étant donné qu'elle n'aura pas le temps de nous la faire... C'est intéressant, mais assez difficile étant donné que je n'ai que très peu de sources... J'ai déjà rédigé une introduction où j'expose les grandes questions de mon sujet (l'art). Le plan est, je le reconnais, assez maladroit. J'ai souvent des problèmes d'agencement d'ailleurs ;-( [...] En ce qui concerne mes deux premières parties, je n'arrive pas tellement à coordonner les éléments entre eux. Je pensais utiliser des extraits de l'oeuvre de Kant (Critique de la faculté de juger) dans ma première partie, ainsi que des Beaux-Arts, etc. J'espère avoir été un peu plus claire... Merci beaucoup de m'avoir répondu. En attendant votre nouvelle réponse... ». |
|
|
=> 02/03/08 : Rebonjour endlessly. Pourriez-vous m'envoyer une version rédigée de votre introduction (disons : 1/2 page à 1 page) ? Vous savez sûrement que c'est dès ce moment de la réflexion que tout se joue. Vous insistez sur votre manque de "sources". C'est sûrement vrai, mais vous avez une difficulté prioritaire à surmonter avant de savoir quoi dire : c'est de savoir quoi chercher. Il faut donc que vous parveniez à formuler un problème philosophique. Je dis bien un problème, un seul, sinon vous allez vous "noyer"... et c'est assez facile avec la question de l'art ;-|° Pour vous aider un peu à démarrer : pourquoi ne pas commencer à vous demander ce que <la philosophie> peut bien avoir à faire avec <l'art> ? La philosophie vise la vérité par un travail conceptuel ; par comparaison, l'art emprunte des voies imagées, joue sur les formes, et peut même sembler même produire un monde d'illusions. Ou encore : le philosophe recherche la sagesse ; le génie artistique semble un proche cousin de la folie... Le philosophe pense laborieusement, tandis que l'artiste est, dit-on, inspiré. Voyez la formulation problématique n°3 dans >>cette page d'introduction<<. Comprenez-vous ? Problématiser, c'est interroger la valeur des oppositions : <philosophie> ≠ <art> ; <concept> ≠ <image> ; <vérité> ≠ <illusion> ; <sagesse> ≠ <folie> ... En l'occurrence, c'est donc se demander si l'art n'est qu'un jeu, voire une tromperie OU si, au contraire (alternative), il peut nous apprendre quelque chose. Cela vous conduira facilement à la problématique n°2 (même page), mais aussi à la n°1.Evidemment, vous pouvez préférer partir de la problématique n°1 : l'art semble "inutile". Vous trouverez un petit échange sur cette problématique dans >>ce courrier<<. Voilà mes petits conseils, bien chère et jeune professeur, et j'attends maintenant votre présentation. De pied ferme... Nous verrons pour le plan dans un deuxième temps, mais ce n'est pas prioritaire, et, à mon (humble) avis, ce n'est pas non plus le plus important : si vous avez une bonne formulation problématique de départ, le plan viendra presque "naturellement" ;-) En attendant de vous lire, bon courage, et recevez mes amitiés. Philia. |
|
|
Endlessly le 02/03/08 : « Bonjour, merci encore une fois d'avoir répondu à mon message. J'ai pris note de vos remarques et vous envoie comme prévu mon introduction. J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'attends à nouveau votre réponse... » Introduction : C'est dans la vie quotidienne que l'art joue un rôle. En effet, celui-ci est très présent, de manière concrète (musées, expositions...) mais aussi sans que l'on y fasse forcément attention (immeuble : architecture ; Place des Terreaux à Lyon : sculpture ; radio : musique...). L'art peut être défini comme la création de belles choses, en d'autres termes l'art serait créateur, fondateur ou encore inventeur de la beauté, du beau. Ainsi, Kant disait : « Le beau est ce qui plaît universellement sans concepts ». Le mot « art » vient du latin ars, artis qui dans l'usage courant renvoyait au sens du métier, de la technique c'est-à-dire dans le domaine de l'activité humaine capable de production, et non seulement le domaine des « beaux-arts » qui prédomine aujourd'hui. De même, l'artiste est d'abord le « maître des arts » avant de devenir l'équivalent de l' « artisan » jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'art n'est originellement nullement différent de l'artisanat, il transforme la nature, agit sur le monde extérieur et s'oppose ainsi à l'action et à la théorie, qui englobe la philosophie et la science. De ce fait, l'art s'émancipe peu à peu de son côté artisanal et productif pour désigner une activité libre dans laquelle l'artiste exerce son talent et sa vision du monde, des choses. L'art manifeste le désir humain de créer du beau, c'est donc en ces termes qu'il est défini en tant qu'inventeur. Il s'agirait donc de savoir si l'art engendre la question du goût, quel est alors le rôle, la fonction de l'art dans la culture ? De cela résulte l'esthétique, théorie de l'art et du beau. Que signifie alors l'expérience esthétique ? De même, l'art transformerait la nature, agirait sur le monde extérieur. Pourtant, à travers les époques, les définitions de l'art se sont multipliées, notamment pour ceux qui considèrent l'art comme reproduction de la nature. En cela, l'ultime question qui s'impose ici est donc de savoir si l'art est imitation de la nature ou entière création. Enfin, puisque l'art existe depuis plus de quinze mille ans et puisqu'il a longtemps été associé à l'artisanat, peut-on dire de nos jours que l'art s'est modernisé ? Existe-t-il ainsi une rupture entre l'art d'autrefois et l'art moderne d'aujourd'hui comme le conclut Hegel ? |
|
|
=> 03/03/08 : Merci Endlessly. Voici ma correction de votre présentation (en rouge, bien sûr !), en espérant que vous pourrez en tirer bénéfice : C'est dans la vie quotidienne que l'art joue un rôle. En effet, celui-ci est très présent, de manière concrète (musées, expositions...) mais aussi sans que l'on y fasse forcément attention (immeuble : architecture ; Place des Terreaux à Lyon : sculpture ; radio : musique...). L'art peut être défini comme la création de belles choses, en d'autres termes l'art serait créateur, fondateur ou encore inventeur de la beauté, du beau. Le mot « art » vient du latin ars, artis qui dans l'usage courant renvoyait au sens du métier, de la technique c'est-à-dire dans le domaine de l'activité humaine capable en général de production, et non seulement au L'art manifeste le désir humain de créer du beau, objet du jugement de goût (ou jugement esthétique). C'est donc en ces termes qu'il est défini en tant qu'inventeur de formes. De même (<= Vous reconnaîtrez facilement que cette locution n'est pas claire : est-ce la même question que celle du §. ci-dessus ou bien une nouvelle question ?), l'art transformerait la nature, agirait sur le monde extérieur. Pourtant, Enfin (<= ?? Là encore, on perçoit mal l'ordre de votre présentation...), puisque l'art existe depuis plus de quinze mille ans (<= Beaucoup plus ! L'art apparaît en même temps que l'homme moderne, soit il y a 35 ou 40.000 ans. Les plus anciennes oeuvres de la grotte Chauvet, découverte en 1994 dans le département de l'Ardèche, datent de – 32.000 ans avant le présent. Les peintures et gravures pariétales de Lascaux sont relativement "tardives" [...tout est relatif ! ~ entre environ 18 000 et 15 000 ans avant le présent]) et puisqu'il a longtemps été associé à l'artisanat, peut-on dire de nos jours que l'art s'est modernisé ? (<= Voulez-vous dire que les changements qui ont lieu dans l'histoire de l'art dépendent essentiellement des techniques utilisées ? Pas clair...) Existe-t-il ainsi une rupture entre l'art d'autrefois et l'art moderne d'aujourd'hui (<= Il est évident que oui ! Cela ne fait donc pas problème...) comme le conclut Hegel ? (<= Il est sans doute trop tôt pour évoquer son nom) ...Voilà que je m'aperçois que je ne vous avais pas averti que je suis extrêmement cruel et méchant. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. ;-(( En résumé : + Votre présentation a des qualités et révèle que vous avez réfléchi à la notion d'art ...D'unité, car votre questionnement est assez dispersé (malgré les efforts manifestes...). Dans le détail : vous évoquez (1°) la question de la technicité présente dans le travail et dans l'oeuvre de l'artiste par oppositon au caractère libéral de l'art => <contrainte> (technique) ≠ <liberté> (créatrice) ; (2°) le caractère pratique de l'activité artistique par opposition au caractère théorique de la philosophie ou de la science => <action> (visant la production d'une belle oeuvre) ≠ <pensée> (visant la vérité de la pensée ou des connaissances) ; (3°) le caractère novateur du geste artistique qui est susceptible d'inventer des formes par opposition à la simple reproduction de la nature => <création> de formes nouvelles ≠ <imitation> de formes déjà données ; (4°) l'opposition possible entre les formes anciennes et les formes plus récentes de l'art => <ancien> ≠ <moderne> ; (5°) la question du jugement de goût => <subjectif> ≠ <objectif>. Il faudrait parvenir : soit à élaguer (= à faire plus simple, à dire un peu moins de choses, quitte à les dire de façon plus précise), soit à relier ces différentes approches les unes aux autres afin d'éviter la juxtaposition (...plus difficile !). ...De précision, car votre questionnement est généralement trop ouvert. Il faut expliciter davantage ce que vous dites. Exemple : pourquoi se demander si l'art "évolue", s'il existe une rupture entre l'art <ancien> et l'art <moderne> ? Pour parvenir à un questionnement à la fois clair et problématique, vous pourriez reformuler cela ainsi : l'art a-t-il une <histoire>, ou bien est-il <éternel> ? Indice (évident) en faveur de la première thèse : on ne peint pas aujourd'hui comme à l'époque de Rembrandt ; il n'y a pas d'art abstrait, et encore moins de photographie ou de cinéma au XVIIe s., etc. Indice en faveur de la seconde thèse : les oeuvres de Rembrandt semblent nous parler encore, comme si elles nous délivraient une vérité éternelle ; même remarque pour les pièces de Molière, ou les poèmes de Ronsard ; même remarque pour la musique de Bach, qui peut nous procurer un plaisir que les auditeurs qui furent ses contemporains ont connu, il y a pourtant plus de 2 siècles et demi de cela (soit dit en passant, les grands compositeurs du passé sont aujourd'hui plus pillés que jamais... ils gagneraient une véritable fortune s'ils étaient encore vivants !). Compris ? Si vous le souhaitez, essayez vous-même avec l'une ou l'autre des autres approches relevées ci-dessus : reprenez, par exemple, ce que vous dites sur l'artiste et l'artisan (= le technicien), et tâchez de problématiser le rapport entre <art> et <technique>. Mais attention : si vous y arrivez, je vous préviens (charitablement, comme on dit) : vous allez PENSER !!! Et ce sera sans fin, chère Endlessly, sans fin ! ...De plus, votre souci de plan risque fort, sinon de disparaître, du moins de s'éloigner ! Je suis certain que vous êtes tentée ;-)° Je reste de toute façon à votre écoute, toujours cruel-et-méchant, mais aussi (vous l'avez compris, bien sûr) bienveillant-et-amical. A vous lire... |
|
|
Endlessly le 03/03/08 : « Rebonjour, et merci pour votre correction très précise. J'ai revu effectivement 2-3 points de mon introduction. Je vous fais part maintenant de mon développement, car j'avais déjà commencé à rédiger ma leçon avant que vous me corrigiez (j'espère que vous ne m'en voudrez pas !). Je n'ai pas tout à fait fini ce développement il reste encore quelques points à finir ou à revoir. Merci encore pour votre écoute et vos bons conseils. » I – Le goût et le génie
II – L'art comme imitation de la nature ?
III – Mort de l'art et art contemporain
|
|
|
=> 04/03/08 : Eh bien ce n'est pas mal du tout ! J'ai corrigé 2 ou 3 fautes en reproduisant votre présentation. Je n'ai pas le temps de tout corriger sur le fond, mais je vous soumets tout de même quelques remarques (puisque c'est vous !) : a) Le début de votre I (= « A) Le beau et l'oeuvre d'art ») gagnerait sûrement à être éclairci. Evoquer successivement Kant et Pie XII, puis Freud et Merleau-Ponty, le tout dans le même paragraphe, alors que leurs propos sont extrêmement différents, c'est sûrement à revoir. Il faudrait au moins expliquer un peu plus, ce qui vous permettrait de souligner les différences. b) Vous écrivez qu'Aristote considérait que l'art prend sa source dans le plaisir de l'imitation. C'est exact, mais il faut prendre la formule d'Aristote (« L'Art imite la nature ») au pied de la lettre : c'est bien l'art, et non l'oeuvre d'art, qui imite la nature. Aristote veut dire que la nature est elle-même "artiste", et que tout l'art de l'artiste consiste à se rapprocher de "l'art divin" qui fait naître et se développer la nature, qui est une véritable merveille : l'art imite la nature parce que la nature est déjà, en quelque sorte, de l'art. c) Sur l'esthétique de Hegel : l'important, pour Hegel, est que l'art a une mission spirituelle. Ce qui en témoigne, c'est le lien qu'il entretient, pendant des millénaires, avec la religion, ou, plus généralement, avec "l'absolu" : l'art doit servir à révéler de façon sensible « l'Idée ». Il doit être l'éclat, dans la représentation concrète (par des traits, des couleurs, des sons...), de l'absolu entendu comme conscience de soi réalisée. Mais cela ne va pas sans difficulté : (1°) les hommes se représentent en effet l'absolu sous la forme du divin. Mais (2°) comment le sensible peut-il figurer l'intelligible, comment l'art, qui est chose humaine, peut-il figurer le divin ? Les réponses ont varié au cours des temps : dans l'art « symbolique », les dieux sont lointains et la figuration colossale (le sphinx, les pyramides...) ; dans l'art « classique », les dieux ont forme humaine, et la figuration paraît "équilibrée" (les statues grecques...). Toutefois, l'art grec ne figure que la perfection des formes, l'harmonie des proportions du corps. Il manque à cet art "équilibré" la vie intérieure. C'est le christianisme qui révélera le premier la nécessité de cette figuration. Le christianisme, en effet, a totalement humanisé le divin (le Christ est l'incarnation humaine de Dieu). L'art chrétien met donc en scène les sentiments, les passions humaines, la joie et la douleur, le coeur et la raison, la foi et le doute, l'espérance et le désespoir, bref, la vie intime de l'esprit : c'est l'art « romantique ». Pourtant, ni la peinture ni la musique ne parviendront à figurer vraiment l'intériorité dans son effectivité et dans toute sa profondeur : l'art est manifestation extérieure, il ne peut atteindre tout à fait l'intériorité. L'art religieux (Kunstreligion), qui est l'art sous sa forme vraie, va alors décliner en même temps que la religion. L'art — l'art moderne, et, à plus forte raison, l'art contemporain — va alors se séculariser, et se tourner vers l'éphémère, le fugitif (contre l'éternel), vers l'accidentel (au lieu de l'essentiel), etc. Voyez >>ce texte<< sur la peinture hollandaise au XVIIe s. C'est le thème de la mort de l'art — toujours bien sûr entendu comme Kunstreligion. L'art, désormais, ne poursuit plus d'autre idéal que lui-même. Voilà. Ce sont des remarques vraiment rapides, mais qui, je crois, peuvent vous aider à y voir encore un peu plus clair. Une dernière remarque : ne croyez-vous pas que votre exposé risque d'être un peu long devant vos camarades de classe ? N'hésitez pas à donner de vos nouvelles. D'ici là, recevez toutes mes...
|
|
-: Amitiés :- P h i l i a.
Référence du message : ID 126
Moteur actif : Cléphi![]() changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide
changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide