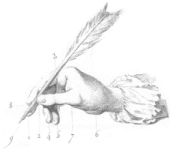Moteur actif Cléphi | courrier - contacter - Philia - |
|
Vous êtes ici : |
La messagerie de Philia édition originale 16-03-2003 actualisée le 12-05-2008 |
|
30/01/2008 |
|
|
De Leïlaaa, qui est en classe terminale, cette demande : « J'ai à rendre très prochainement une dissertation dont le sujet est : "Ne peut-on être heureux que dans l'illusion ?". J'ai déjà des pistes concernant certaines illusions pouvant conduire au bonheur, mais je crains de ne pas être suffisamment exhaustive... J'ai commencé par recenser un certain nombre d'illusions comme la liberté, la conscience comme coïncidence de soi à soi, l'anthropocentrisme, la mauvaise foi sartrienne consiste aussi un refuge face à l'angoisse de l'homme et conduirait donc éventuellement au bonheur... J'envisage en fait l'illusion comme "rempart" à la réalité, à la vérité trop difficile à accepter. Par ailleurs je comptais développer l'idée que l'on ne peut être heureux dans l'illusion car la conscience d'être dans l'illusion empêche d'apprécier cette situation, mais je ne trouve rien qui aille vraiment dans ce sens... En fin de compte je ne parviens pas à réellement organiser mon propos et je crains de m'éloigner du sujet, de trop me disperser sans vraiment le traiter, d'occulter des réflexions importantes. Si vous pouviez m'aider...! Merci beaucoup d'avance ! » |
|
| => 31/01/08 : Euh... Qu'appelez-vous "très prochainement" ? Pas demain matin, j'espère, car il faut que je fasse dormir mes yeux ! Faites-moi savoir "en quatrième vitesse" combien de temps vous m'accordez, et je verrai (pas à faire votre devoir, hein ? juste à vous dépanner un peu !). Bon, alors déjà, 2 petites remarques : (1°) Il n'est pas nécessaire d'être exhaustif ! (2°) Il y a une phrase qui "sonne un peu bizarre" dans votre message, bien chère Leïlaaa (il y a vraiment tous ces 'a' dans votre prénom ??) : « on ne peut être heureux dans l'illusion car la conscience d'être dans l'illusion empêche d'apprécier cette situation ». C'est bizarre, en effet, puisque, par définition, celui qui est dans l'illusion ne sait pas (= n'a pas conscience) qu'il est dans l'illusion. Dès lors, comment pourrait-il être malheureux d'être dans l'illusion ? Il n'en sait rien, le pauvre. On peut bien le plaindre, de l'extérieur, y compris concernant son inconscience, mais lui ne peut pas se plaindre. Non ? Qu'en pensez-vous ? Pensez aux prisonniers de la caverne de Platon : ils ne savent pas qu'ils sont prisonniers / qu'ils sont dans l'illusion ; ils ne sont donc pas malheureux... même si Platon nous apprend qu'en fait, si, ils sont vraiment très malheureux, ce dont l'un d'entre eux, après avoir été libéré, finira pas convenir. A bientôt. Sinon, bon courage pour votre travail à remettre "très prochainement" ! |
|
| Leïlaaa le 1er Février : « Me revoilà ! Le très prochainement signifie pour Mercredi (le 6/02). J'espère que ce ne sera pas trop juste ! Concernant ma phrase "bizarre" il est vrai que je n'étais pas très sûre de moi... Je tâtonne un petit peu dans l'espoir d'aboutir à quelque chose de sensé et structuré ! Pour en revenir à l'illusion de la caverne chez Platon, puisque justement ils n'ont pas conscience d'être malheureux peut-on dire qu'ils le sont vraiment ? Leur condition semble les rendre heureux pour autant qu'ils ne connaissent pas la réalité... J'espère que vous aurez un peu de temps pour m'aider ! Merci.
»
|
|
| => 03/02/08 : Rebonjour Leïlaaa (franchement, c'est bizarre tous ces "aaa", non ?). Je réponds d'abord à votre demande : faut-il considérer que les prisonniers dans la caverne sont heureux ou bien malheureux ? Je dirais qu'il faut répondre qu'ils sont ignorants ; et doublement, puisqu'ils ignorent qu'ils ignorent. Dès lors, ils s'imaginent qu'aucune place ne vaut celle qu'ils occupent. Aussi croient-ils vivre dans la condition la plus heureuse. Et l'on comprend aussi qu'ils se montrent réticents, et même agressifs, lorsque le prisonnier libéré leur propose de s'évader, de monter avec lui tout en haut, dans le monde intelligible, où ils seront plus libérés de leurs chaînes, et, contemplant le monde réel dans toute sa splendeur, connaîtront un bonheur sans pareil. Le problème (voyez-vous bien) avec les illusions, c'est qu'elles nous plaisent, qu'elles nous paraissent aimables. C'est pourquoi on ne les corrige pas : on les perd, comme à regret, comme on perd un être cher, que l'on déplore de quitter, parce que, "malgré tout", il nous faisait du bien : on corrige une erreur, on perd une illusion ; jamais l'inverse. Une illusion est donc une erreur à laquelle on tient, parce qu'elle nous console, ou nous fait espérer, ou parce qu'elle nous flatte. ; bref, une illusion est une erreur teintée de désir. Elle est une idée fausse à laquelle, pourtant, on tient, et que, du coup, on ne peut abandonner sans quelque chagrin. C'est donc, pour ainsi dire par définition, que l'illusion est illusion de satisfaction, et même, de bonheur.
L'attitude platonicienne consiste, vous l'avez compris, dans un optimisme : il y a, par-delà notre obscure caverne, un monde plus lumineux, plus beau et plus vrai, où nous pouvons être plus libres et plus heureux. L'illusion est un triste bonheur, une condition fausse et aliénante. La révélation de la vérité, au contraire, est libératrice, et nous fait accéder à un "gai savoir". L'illusion, l'étymologie nous le révèle, désigne une apparence trompeuse, une apparence flatteuse dont nous sommes les victimes, en principe consentantes : illudere, en latin, c'est « se jouer (de), se moquer (de) » (c'est un dérivé de ludere, « jouer » — qui donne le français ludique). Etre dans l'illusion, c'est donc être le jouet d'une apparence, et cela non sans délectation, non sans une certaine impression de bonheur. Mais, au sens strict, l'illusion, pour parler familièrement, se fiche de nous ! Platon a d'ailleurs bien pris soin, au début de son récit, de nous préciser que ces hommes sont prisonniers depuis leur naissance : ils n'ont rien connu d'autre, et c'est pourquoi ils sont satisfaits de leur sort. Ils sont enchaînés au point de ne pouvoir tourner la tête, et pourtant cette condition leur paraît confortable. Votre sujet, quant à lui, semble suggérer une tout autre idée que celle que suggère Platon (pour qui il est possible d'extraire de l'illusion "par le haut" en accédant au bonheur véritable), une idée radicalement pessimiste : le bonheur n'est pas de ce monde, et il n'y a pas d'autre monde que ce monde. Rien au-dessus de la caverne. Aucun espoir, donc, d'en sortir. Dès lors ne peut-on être heureux que dans l'illusion d'être heureux. Cette thèse désespérée — et désespérante, que vaut-elle ? C'est la question. Bien sûr, on peut l'édulcorer, par exemple en soutenant que nous pouvons faire de doux rêves, mais ce sera toujours pour dire que la (triste) réalité ne vaut pas la peine d'être regardée en face. Donc, même ainsi édulcorée, la thèse revient à affirmer (quoi qu'en dise Rousseau) qu'il n'y a pas de vrai bonheur possible. Reste à dire précisément pourquoi... Schopenhauer, bien connu pour son pessimisme radical, écrit que « La vie [...] oscille, comme un pendule [...] de la souffrance à l'ennui ». Pourquoi, demandera-t-on à nouveau ? Parce que nous sommes animés par le désir, et que le désir est manque, et donc souffrance. Le désir est-il satisfait ? Nous sommes alors insatisfaits de la satisfaction, car le désir, en réussissant son "suicide", meurt, et inéluctablement renaît sous une autre forme, toujours aussi douloureux. Le désir s'éteint-il ? C'est l'ennui. Se ravive-t-il ? C'est à nouveau la souffrance. La vie est un long fleuve inquiet. Tout juste, comme par une grâce, les hommes les plus intelligents peuvent-ils éprouver les joies fulgurantes de « la connaissance pure, pure de tout vouloir, la jouissance du beau, le vrai plaisir artistique ; encore ces joies, pour être senties, demandent-elles des aptitudes bien rares : elles sont donc permises à bien peu, et, pour ceux-là même, elles sont comme un rêve qui passe », mais ces joies sont brèves, et leur intelligence fait d'eux « en somme, des solitaires au milieu d'une foule toute différente d'eux » (extrait ici). Il peut donc bien y avoir, pendant un temps, des illusions heureuses, et, pour certains hommes rares, des moments de joie intense, mais le bonheur, si l'on entend par là un état stable, ne peut être qu'une illusion de bonheur. Il n'y a donc de bonheur que dans l'illusion (du bonheur). Voilà. Pour le reste, je veux dire la solution, je ne peux rien dire, puisqu'elle doit être votre solution (à énoncer dans la conclusion, et à développer dans la dernière partie de votre dissertation). Vous pourriez par exemple vous demander, au-delà du pessimisme schopenhauerien, si cette notion de bonheur est vraiment "sérieuse". Kant, notamment, n'y a vu qu'un « un idéal de l'imagination », et, à ce titre, individuel : on ne peut par suite préconiser aucune règle universelle pour l'atteindre. Du reste, à bien y réfléchir, ce qui rend cette tâche impossible, c'est que « malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut ». Autrement dit, non seulement nul ne peut dire avec certitude ce qu'est "le bonheur", mais même nul ne peut connaître à l'avance quelles sont les conditions empiriques qui sont susceptibles de le rendre heureux !... Ce qui serait illusoire, alors, ce serait la recherche du bonheur, puisque nul ne serait capable d'en définir les contours. D'ailleurs, le bonheur est-il vraiment le bien ? Certes, tous les hommes cherchent à être heureux, mais cela prouve-t-il que le bien soit le bonheur ? Nous devrions plutôt, soutient Kant, tâcher de nous rendre moralement « dignes d'être heureux »... Mais peut-être pourriez-vous aussi méditer la différence entre <bonheur> et <joie>, déjà suggérée par Schopenhauer dans les extraits cités, et évoquée par Bergson ? Ou alors, plus audacieusement, tenter de définir le bonheur comme achèvement de la vie humaine : le bien, c'est le bonheur, et ce qui nous rend vraiment heureux, c'est de tendre vers la perfection de notre être. Aristote ajouterait : la perfection, pour l'homme, en tant qu'il est doué de raison, c'est la perfection de la pensée. Je n'en rajoute pas (on pourrait penser aussi à "mobiliser" Epicure ou les stoïciens...), de peur de vous embrouiller, d'autant qu'il vous reste, si j'ai bien compris, peu de temps. Tâchez donc de l'employer bien, sans trop vous disperser, et en cherchant d'abord à quelle conclusion vous aimeriez parvenir. N'hésitez pas à donner de vos nouvelles. Avec mes... |
|
-: Amitiés :- P h i l i a.
Référence du message : ID 125
Moteur actif : Cléphi![]() changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide
changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide