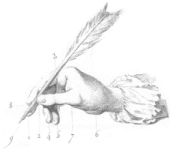|
De Manus, le 26/04/2008 : « Se juge-t-on les uns les autres par rapport à notre inconscient ? Le physique étant exclu, qu'est ce qui nous différencie ? Je vous explique ma démarche : depuis mon cours de philosophie sur la conscience (je suis en terminale S) quelques questions me préoccupent. Si la conscience est la capacité de se remettre en question, qu'elle soit synonyme de choix, ou encore qu'elle représente une pensée véritablement connue qui soit plus présente que les autres dans notre esprit, qu'est-ce qu'alors que l'inconscience ? On traduit souvent l'inconscience par l'habitude, qui ne nécessite pas de réflexion, donc de choix, mais on l'utilise aussi pour expliquer les fonctionnements et dysfonctionnements de l'esprit. Il semble donc que l'on se sert de notre inconscient tout le temps, ne serait-ce qu'avec nos réflexes, pour marcher, parler, se souvenir. Cependant la mémoire me pose quelques problèmes : c'est grâce à la raison que l'on remplit notre mémoire, à l'aide de déductions, d'analyses et de comparaisons. Le raisonnement implique des choix, donc la conscience. Mais lorsqu'une autre pensée vient remplacer celle du raisonnement à peine fondé, celui-ci est aussitôt "enfoui" dans la mémoire inconsciente, sinon il y aurait bien entendu énormément de choses à penser. Ainsi comment récupère-t-on nos souvenirs ? L'inconscient nous livre-t-il quelques morceaux mélangés, triés par la conscience ? Quelles sont ces idées qui nous viennent de "nulle part" lorsque l'on tente de faire ce tri ? Nos facilités dans certains domaines (musique, mathématiques, littérature, culture, ...) sont-elles les conséquences de la mémoire traitée par l'inconscient ? La psychanalyse a-t-elle un rapport ? Et enfin, sommes-nous susceptibles d'être jugés par notre inconscient ? Voici en quelques lignes mon problème... Peut être me suis-je trompé dans tout ce raisonnement, car je n'ai pas bien approfondi (trop long) et que la philosophie est toute nouvelle pour moi. C'est d'ailleurs pourquoi je vous fais part de mon problème car il me manque la connaissances de quelques oeuvres pour m'aider à le résoudre, comme par exemple la psychanalyse de Freud.
J'espère que vous porterez de l'attention à mon sujet, et vous en remercie d'avance. »
|
 |
=> 02/05/08 : Bonjour Manus. J 'y porte de l'attention. Je vais tâcher de vous répondre aussi simplement que possible.
Si je comprends bien votre message, il revient à demander ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Quelle est la part de la mémoire dans notre identité — et si cette mémoire ne serait pas inconsciente ? ...Vaste question, vous en conviendrez !
Pour alimenter votre réflexion, il faudrait sans doute d'abord mieux définir les notions, ce qui serait sûrement facilité si elles étaient plus exactement distinguées les unes des autres. Ainsi, dans votre message, vous ne semblez pas différencier clairement <inconscient> et <inconscience>. Or ces concepts sont bien différents : l'<inconscience> désigne un état, l'<inconscient> désigne une activité psychique que l'on suppose gouverner secrètement notre vie mentale consciente. De même, la <mémoire> est la faculté de retenir une trace du vécu et de rappeler cette trace ; le <souvenir> est une conscience qui fait preuve de mémoire, et, surtout, qui le sait : lorsque je me souviens, je reconnais avoir affaire à une trace du passé, autrement dit je sais que je me souviens. En ce sens, il n'y a donc pas de souvenir inconscient : ce qui hante notre mémoire sans qu'on s'en aperçoive n'est pas rappelé comme quelque chose de mémorisé. Leibniz évoquait cette vie psychique obscure faite de "petites perceptions" échappant à notre vigilance comme un immense domaine : celui de l'<inconscience>. Ainsi, pour lui, il faut aller jusqu'à dire que « toutes nos actions délibérées sont des résultats d'un concours de petites perceptions, et même nos coutumes et passions, qui ont tant d'influence dans nos délibérations, en viennent; car ces habitudes naissent peu à peu [...] » (voir ce texte). Parler d'<inconscient>, c'est évoquer un tout autre ordre de phénomènes. En effet, les petites perceptions au sens de Leibniz sont certes "silencieuses", mais non pas secrètes : nous pouvons par exemple, par un effort d'attention, nous rendre conscients d'une habitude, et même nous souvenir des étapes par lesquelles nous l'avons "insensiblement" acquise. Au contraire, la psychanalyse évoque l'<inconscient> comme un registre dissimulé
de la vie psychique. Le prototype de cette vie psychique dissimulée est, comme vous le savez probablement, le refoulement : « Ce qui est refoulé est pour nous le prototype de l'inconscient » (voir ce texte). Ainsi, dès les premiers pas de la psychanalyse, Freud évoque le cas des hystériques, qui « souffrent de réminiscence ». Une <réminiscence>, au sens courant du terme, est un souvenir vague, mais les psychologues utilisent ce terme pour désigner un souvenir actif qui n'est pas reconnu comme tel. En quelque sorte, le <souvenir> est une mémoire consciente (ou, comme nous disions, une conscience qui fait preuve de mémoire) ; la <réminiscence> est, quant à elle, un souvenir auquel la conscience fait défaut. En simplifiant, on pourrait proposer les "équations" suivantes :
- <souvenir> = <mémoire> + <conscience>
- <réminiscence> = <souvenir> – <conscience>
...en prenant le signe « – » comme le signe d'un défaut, d'une lacune.
Ainsi, l'<inconscient> n'est pas la simple <inconscience>, même celle pourtant déterminante des "petites impressions" inaperçues évoquées par Leibniz, mais le registre du lacunaire, et de la résistance de certains faits psychiques à la prise de conscience du lacunaire : l'inconscient, c'est ce qui résiste à la conscience (et à l'effort d'attention dont nous parlions plus haut), ce qui "refuse" d'accéder à la conscience. Et la "réminiscence" dont fait preuve l'hystérique a donc le sens d'un symptôme, puisqu'elle est le signe pathologique "parasite" qui atteste de l'activité du refoulé : elle a en effet le sens d'un "retour du refoulé", ou, si l'on préfère, d'une fixation parasite au passé. Pour faire comprendre le rôle joué par cet attachement pathologique au passé, Freud propose de le comparer à l'attitude étrange « d'un habitant de Londres qui, aujourd'hui encore, s'arrêterait mélancoliquement devant le monument du convoi funèbre de la reine Éléonore » (XIIIe siècle), ou encore « d'un autre qui pleurerait devant « le monument » la destruction de la ville » par le grand incendie de 1666 (première des Cinq leçons sur la psychanalyse). Les hystériques, tels ces étranges londoniens, sont victimes d'un passé qui ne passe pas. Ils souffrent d'une indigestion du passé. Freud dit : ils souffrent de réminiscence.
...Pour en venir à votre question, il faudrait donc au moins tenir compte de cette différence fondamentale entre les déterminations inconscientes au sens large (ce que nous avons appelé ci-dessus l'<inconscience>), et les effets de l'inconscient au sens psychanalytique. Mais ce n'est pas facile en peu de mots, car votre question est en fait multiforme : vous vous demandez en effet (1) comment nous sélectionnons nos souvenirs, puis (2) si « nos facilités dans certains domaines (musique, mathématiques, littérature, culture, ...) sont [...] les conséquences de la mémoire traitée par l'inconscient », et finalement (3) si nous sommes « susceptibles d'être jugés par notre inconscient ? ». A vrai dire, cela fait bien trois questions distinctes, même si on comprend bien qu'elles sont liées...
- C'est probablement, du fait de son amplitude, la question qui mériterait les plus longs développements. On pourrait dire, brièvement, que la vie psychique consciente provient en partie de nous, mais qu'elle provient tout autant d'une activité inconsciente, dans l'un ou l'autre des sens du terme. Difficile de développer davantage dans le cadre de ce courrier. Voyez tout de même ce message dans le courrier de Philia.
- La notion de « facilité » que vous utilisez dans votre deuxième question n'est pas une notion si... facile ! Elle tient probablement à des dispositions naturelles (Platon évoquait ainsi un « naturel philosophe », une sorte de "terrain" prédisposant à philosopher !), mais aussi, et sans doute surtout, (a) aux influences sociales : J.-S. Bach appartenait à une longue lignée de musiciens, et plusieurs de ses enfants ont également composé ; de même, le papa du jeune Mozart a bien facilité le développement du génie musical de son rejeton ; (b) à des "déterminants intrapsychiques" en grande partie inconscients (à nouveau dans les deux sens du terme). Vaste sujet, donc, là aussi...
- Enfin, sommes-nous jugés par notre inconscient ? Ainsi formulée, la question ne manque pas d'être paradoxale. En effet, "notre inconscient", c'est nous, aussi ! Un psychanalyste vous répondrait peut-être en termes un peu techniques : cette fonction de "juge" revient en effet au surmoi, instance en grande partie inconsciente qui se charge de punir ou de féliciter le moi, selon ses orientations, et notamment sa plus ou moins grande complaisance à l'égard des exigences pulsionnelles du ça. Le surmoi, vous expliquerait-il encore, est l'intériorisation des exigences et des interdits parentaux. Ayant cette origine, il est donc plus ou moins exigeant et plus ou moins sévère...
Bref, vous avez sans doute compris que vos questions étaient assez difficile, sans doute plus que vous ne l'imaginiez ;-))
Pour finir : sur la notion d'inconscient, vous n'êtes pas le premier à vous méprendre. On se souvient d'une célèbre visite d'André Breton au cabinet viennois du vieux Docteur Freud. Pour "le pape du surréalisme", il ne faisait pas de doute que « la vie véritable réside dans cette nappe profonde qui affleure à la conscience dans le rêve et l'inspiration ». En quelque sorte, "l'inconscient" de Breton était la muse du poète, et, bien sûr, Freud ne l'entendait pas du tout de cette oreille (même si Freud a écrit sur l'activité artistique) ! N'étant pas sur la même "longueur d'onde", les deux (grands) hommes ne se sont jamais compris...
Voilà : ce sera tout pour aujourd'hui ! Je vous conseille vivement de lire des auteurs pour y voir plus clair... Vous pourriez peut-être commencer par un ouvrage abordable et agréable, pas trop long : les Cinq leçons sur la psychanalyse, par exemple : ce n'est pas la mer à boire (en tout 38 pages au format A4), et comme il s'agit de conférences destinées à un large public, vous ne serez pas noyés par la technicité des propos. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage en librairie (aux éditions Payot), ou alors au C.D.I. de votre établissement, ou encore le télécharger gratuitement ici : http://classiques.uqac.ca...
Bonne lecture. Et bon courage pour cette dernière ligne droite avec l'examen. N'hésitez pas à donner de vos nouvelles. Avec toutes mes...
|
![]() changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide
changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide