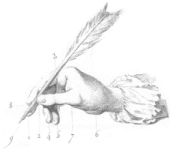Moteur actif Cléphi | courrier - contacter - Philia - |
|
Vous êtes ici : |
La messagerie de Philia édition originale 16-03-2003 actualisée le 12-05-2008 |
|
28/10/2004 |
|
|
|
De Marie, qui est en hypokâgne, le 28/10/04 : "Tout d'abord félicitation pour votre site ! J'ai trouvé des choses très intéressantes et j'ai été agréablement surprise car tous les sites internet ne sont pas à ce point riches ! |
|
=> 30/10/04 : Chère Marie, Notez que des sujets assez proches ont été évoqués dans le courrier de Philia, par exemple celui-ci ou celui-ci, ou encore celui-là. Ces messages confirment que votre question finale est très pertinente : dans quelles circonstances, dans quels domaines suivre l'opinion ? Vous savez que la "morale provisoire" de Descartes a tranché là-dessus (Discours de la méthode, III) : la morale n'est pas une science, mais l'action ne souffre aucun délai ; donc il faut suivre une certaine opinion. Pas n'importe laquelle, bien entendu, mais on ne peut là-dessus suspendre son jugement et s'abstenir d'agir... D'ailleurs, s'abstenir d'agir, c'est encore une façon d'agir. De même, existe-t-il vraiment une science politique ? Sinon, faut-il s'abstenir de faire des lois ? Vous pourriez donc peut-être utiliser toute votre deuxième partie à montrer les limites de la connaissance, avec Descartes et Kant par exemple. Dans la partie III, il pourrait alors s'agir d'examiner quelle place accorder à l'opinion : ainsi, faut-il penser, avec Descartes, qu'une certaine opinion "raisonnable" doit être suivie ? Ce serait prudent. Mais peut-on se contenter d'être prudent ? Descartes, par exemple, nous recommande d'obéir aux lois et aux coutumes de notre pays... Le précepte paraît bon. Mais que dire au prince ? A lui aussi faut-il recommander la prudence de suivre l'opinion ? Le prince peut-il prendre l'opinion pour guide si l'opinion se règle elle-même sur les lois ? Ne tombons-nous pas ici dans un cercle, celui de la pensée unique ? Ainsi, constate amèrement Alain : "Les citoyens interrogent le pays, au lieu de s'interroger eux-mêmes. Les gouvernants font de même, et tout aussi naïvement". Il ne faut pas oublier que l'opinion, qui se mêle à peu près de tout, a une opinion d'elle-même : par exemple, elle se croit vraie, alors qu'elle ne l'est pas (cf. votre première partie). Mais aussi elle se croit diverse ("chacun son opinion"), alors même qu'elle est uniforme ! Votre sujet le suggère d'ailleurs à demi mots : L'opinion - au singulier - est elle un bon guide ? Nous ne pouvons donc peut-être pas dépasser l'opinion, mais l'opinion reste pensable ; nous pouvons au moins réfléchir ses limites, nous pouvons la juger. Et c'est au fond ce que vous dites dans votre troisième partie : si nous suivons aveuglément l'opinion, nous risquons le fanatisme, ou plus ordinairement la bêtise. La discussion est donc nécessaire. Certes, il y a des débats d'opinions, mais, le plus souvent, ces débats tournent au combat, ou se cantonnent mollement au simple échange. Mais la discussion n'est pas le débat. La discussion est débat rationnel. Il est symptomatique que la télévision nous abreuve de débats et nous dispense de toute discussion. "L'homme est raisonnable ou bien il a une raison : c'est ainsi que s'exprime pour l'homme de la discussion le contenu de sa certitude. Le langage est tel que la discussion peut aboutir à l'accord." (Eric Weil). Dans le débat au contraire, les dés sont pipés : il est entendu d'avance que chacun campera sur ses positions. Ou alors, ruse suprême, tout le monde "s'entendra" sans s'expliquer : c'est le consensus mou. Tout le problème est dans cette perpétuelle hésitation entre pluralité et unanimité : la pluralité des opinions est stérile, mais l'unanimité n'est pas moins inquiétante. Au contraire, comme le souligne fortement E. Weil, "c'est en tant qu'universel qu'il [= l'homme] est individu pensant [...] Dans son essence, l'individu n'est pas un homme, c'est l'homme", et c'est ce que la discussion véritable a pour fin de révéler. Voyez Platon : il aurait pu exposer ses idées dans des traités, mais il écrit des dialogues. La vérité, pense-t-il, est l'opinion corrigée grâce à la discussion. Elle ne s'oppose donc pas simplement / statiquement à l'opinion. Sans la médiation de la discussion, la vérité ne se distinguerait guère de l'opinion la plus dogmatique. La vérité est l'opinion redressée. Voyez Bachelard : "Le réel n'est jamais « ce qu'on pourrait croire » mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. [...] En revenant sur un passé d'erreurs, on trouve la vérité en un véritable repentir intellectuel." Tout l'art d'enseigner est peut-être dans cette considération. L'accès à la vérité ne peut être que dialectique : il ne faut pas croire qu'il faille croire la vérité. La vérité n'est littéralement pas croyable. Le professeur peut bien s'évertuer à "dire la vérité" sans considérer l'opinion à redresser : en fait, alors, il se tue à dire la vérité, en pure perte. Et l'élève aussi devrait le comprendre, car "un sot n'est point tant un homme qui se trompe qu'un homme qui répète des vérités, sans s'être trompé d'abord comme ont fait ceux qui les ont trouvées" (Alain). En d'autres termes, on peut suivre la vérité exactement comme on suit l'opinion, c'est-à-dire bêtement. Voilà, j'ai été un peu vite, comme toujours, mais si j'ai bien compris, il vous reste encore un peu de temps pour terminer votre travail, qui est déjà bien engagé, bien, dans les deux sens du terme. Bon courage. Et donnez de vos nouvelles. => 31/10/04 : Chère Marie, Bien reçu votre nouveau plan détaillé. Je ne le reproduis pas intégralement ici car il contient de nombreuses abréviations, et les moteurs de recherche - notamment ceux de Philia - les avaleraient sans rechigner, ce qui n'est pas souhaitable. J'indique juste vos titres et les transitions envisagées, avec quelques modifications (changements : Ce qui donne :
Comme vous voyez, je modifie sensiblement votre proposition pour la partie 3. Dans cette dernière partie, vous écrivez en effet : "il faut corriger l'opinion [...] grâce à la discussion". Je ne sais pas s'il faut aller jusque là, car votre 1e partie aura montré que l'opinion était "incorrigible" : vous risquez donc la contradiction. Qu'en pensez-vous ? Personnellement, je proposerai plutôt de dire, dans cette 3e partie, que l'opinion n'est qu'un pis-aller, et que même raisonnable on ne peut se contenter de la suivre. On doit continuer de la penser pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une connaissance insuffisante. Dans le cas évoqué par la partie 2, la discussion ne peut donc intervenir pour la "corriger" (comme pour le cas évoqué dans la partie 1 - cf. Bachelard), puisque la partie 2 aura établi que, dans certains cas du moins, l'opinion peut légitimement guider l'action faute de pouvoir être remplacée par la science correspondante. Il s'agit seulement de la prendre en compte, de l'accueillir - sans agressivité - et lui faire prendre conscience qu'elle n'est qu'une opinion, même quand on peut raisonnablement la juger raisonnable, car la raison, que la discussion présuppose et révèle à la fois (Eric Weil, extrait déjà évoqué), est plus que le raisonnable : la raison pose des exigences et appelle l'accord, mais comme déjà suggéré, ce qui est exigé et appelé est l'universalité, qui se réalise dans un accord de droit, et pas simplement l'unanimité, qui n'est qu'un accord de fait, même quand l'accord en question peut être dit "raisonnable". En quelque sorte, dans cette partie 3, il s'agirait de soutenir que l'opinion prudente (partie 2) doit être consciente d'elle-même, c'est-à-dire réfléchie. Elle doit se savoir opinion. Descartes disait-il d'ailleurs vraiment autre chose dans son Discours ? Ainsi, la morale de Descartes peut bien ressembler à la morale de M. Tout le monde : "obéir aux lois et aux coutumes de mon pays", par exemple, n'est-ce pas en effet ce que presque tout le monde fait, de par le monde ? Pourtant, la morale cartésienne est d'ordre philosophique. Elle est rationnelle, alors que la morale commune n'est qu'une sorte de conformisme (voyez ce que j'écrivais plus haut sur le risque de la "pensée unique"). Descartes a pensé, au sens où la pensée est bien, comme disait Platon, "le dialogue de l'âme avec elle-même". Mais un élève qui apprendrait par coeur sa morale (on peut rêver...) et qui l'appliquerait à la lettre, serait sans doute "raisonnable", mais diriez-vous qu'il exerce vraiment sa raison ? Comme on dit, la vérité n'est pas dans le cahier du maître ! L'essentiel, vous l'avez compris, n'est donc pas ici "la discussion" elle-même, mais la réflexion rationnelle qu'elle rend possible : la discussion est le modèle de la démarche qui nous permet de "rester intelligent", quand bien même nous sommes condamnés à rester dans l'opinion. Prendre l'opinion la plus raisonnable pour guide est sans doute un bon précepte, mais l'opinion la plus raisonnable n'est pas pour autant un bon guide : c'est ce que nous devons le savoir. Et le "nous", ici, ce n'est pas seulement moi : car tout homme a aussi bien que moi le devoir de penser l'opinion pour ce qu'elle est, faute de quoi c'est le suivisme, le conformisme, et même une forme de bêtise, car une opinion, un préjugé, même "bon", ce n'est encore qu'une opinion, ce n'est encore qu'un préjugé. D'ailleurs, qu'est-ce au juste que le raisonnable ? Sauriez-vous le dire concrètement ? Pour réciter encore Descartes, "obéir aux lois et aux coutumes de mon pays", cela va bien, sans doute, dans un pays calme, aux moeurs apaisées et aux lois respectueuses des personnes. Mais, avec un peu d'imagination, un nazi qui aurait lu le Discours de la méthode en 1933 (il s'en est bien trouvé, vers la même époque, pour se délecter de Kant !), un tel personnage trouverait lui aussi que cela va bien. Preuve (s'il en fallait) que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et que les meilleures opinions du monde, exprimées dans les maximes les plus raisonnables, en apparence, peuvent se révéler dévastatrices en réalité. Même la philosophie, donc, peut jouer le rôle de l'opinion (voyez cet extrait de Heidegger). Restons donc intelligent même quand nous adoptons une opinion ! Cela vaut, comme vous le soulignez, dans tous les "domaines qui engagent des choix individuels" : typiquement, l'opinion politique. Encore que, rappelez-vous ce que nous disions, l'opinion a tôt fait de se croire individuelle et originale (c'est l'opinion que l'on se forme concernant notre opinion)... alors qu'elle dépend en réalité de nombreux facteurs collectifs... Il faut penser l'opinion en termes sociologiques. Voyez les précautions prises par les sondeurs, qui demandent toujours à connaître et l'âge et le sexe, quand ce n'est pas la profession, etc. Ces choix sont donc individuels en ce qu'ils nous engagent : ils sont subjectifs. Mais l'opinion que nous choisissons alors n'est probablement pas pour autant personnelle : elle n'émane pas de notre personne, c'est-à-dire d'une réflexion autonome : l'opinion est hétéronome, qu'elle s'introduise en nous subrepticement, ou qu'un "boutiquier débitant les denrées dont l'âme se nourrit" (c'est-à-dire un sophiste), comme dit Platon, s'y soit appliqué. Pensez au concept d'idéologie (voir par exemple Engels). Voilà. J'espère que je n'en ai pas trop dit (sinon, vous me direz quelle note j'ai eue !), et qu'il y en a tout de même assez et assez clairement dit (sinon, n'hésitez pas à râler !). Mes remerciements pour vos compliments (qui m'ont fait un peu rougir, et que je n'ose reproduire ici). |
|
-: Amitiés :- P h i l i a.
Référence du message : ID 046
Moteur actif : Cléphi![]() changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide
changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide