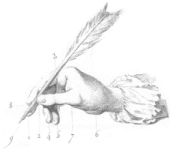Moteur actif Cléphi | courrier - contacter - Philia - |
|
Vous êtes ici : |
La messagerie de Philia édition originale 16-03-2003 actualisée le 12-05-2008 |
|
07/12/2004 |
|
|
|
A nouveau de Chateaubriand, le 07/12/2004 : "Bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre réponse du mois d'octobre sur "Peut forcer quelqu'un à être libre ?". Bien que votre missive me soit parvenue au terme de ma rédaction, elle aura eu au moins l'avantage de soutenir mes choix. Mais le sujet qui m'occupe aujourd'hui touche à la technique et à l'éthique, plus précisément "La technique peut-elle changer l'éthique ?". J'y ai naturellement réfléchi et je suis assez indécis dans la tenue de mon plan que je qualifierai pour le moment d'assez classique : |
|
=> 10/12/04 : Rebonjour Chateaubriand. Merci de votre appréciation positive, et surtout merci de vous proposer pour traduire Philia en : anglais / allemand / italien / espagnol / russe / et (bien sûr) en hébreu et en arabe ;-)) Votre travail contient déjà des éléments fort intéressants, mais il me semble pourtant que vous n'exploitez pas totalement l'énoncé du sujet. Vous pourriez en effet faire apparaître plus explicitement les concepts saillants (la technique = concept X, et l'éthique = concept Y) et "jouer" davantage sur l'ambiguïté de la notion de changement. Voyons cela de plus près : Pour aller vite : qu'est-ce qui fait que la question se pose ? => La technique désigne la pratique rationnelle au service de la transformation du monde par les hommes. Sa visée est donc purement utilitaire L'éthique elle aussi doit être fondée en raison, mais son souci n'est pas d'abord celui des moyens : l'éthique pose en effet le problème des fins. Ainsi, la fin éthique la plus haute est, non l'utile, mais le bien (= le "souverain bien"). La question, qui revient à s'interroger sur les "retombées" de la technique sur l'éthique, demande donc si la réalisation des moyens (techniques) peut ou non changer les fins (éthiques). En d'autres termes : qui gouverne ? L'éthique est-elle autonome, OU BIEN faut-il reconnaître que les "avancées" de la technique sont capables de l'infléchir ? Il faudrait, dans ce dernier cas, parler d'hétéronomie... Mais une telle dépendance n'est-elle pas contraire à l'exigence éthique ? En effet, celle-ci n'est-elle pas, par essence, inconditionnelle ? Ainsi, devons-nous le respect à autrui "sous réserve" de quoi que ce soit ? Ne devons-nous pas plutôt respecter autrui sans condition ? Bref, en examinant le concept d'éthique, on ne voit pas du tout "de quel droit" la technique pourrait l'infléchir... Et pourtant, c'est un fait, la technique façonne nos vies, nos moeurs ; dès lors, n'est-on pas fondé à confondre la morale et les moeurs, l'exigence (=ce qui doit être) et le fait (=ce qui est) ? Ce problème est d'ailleurs suggéré une seconde fois dans l'énoncé par l'ambiguïté du verbe pouvoir : la question est en effet de savoir non seulement si la technique est capable (="peut") de changer l'éthique, mais aussi si elle est en droit (=si elle "peut", en un tout autre sens) de le faire. Cette analyse conduit donc à opérer une distinction entre les pouvoirs de la technique (= de quoi est-elle capable ?) et les droits de la technique (= les changements qu'elle opère sont-ils légitimes ?), distinction essentielle que vos parties II et III, me semble-t-il, ne prennent pas clairement ou pas suffisamment en compte. Plus précisément, nous savons que la philosophie a d'abord vu en la technique moderne (celle qui se développe à partir du XVIIe siècle comme application de connaissances scientifiques) un espoir considérable : son utilité était telle qu'elle devait permettre de "nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature" (Descartes). Il est vrai que la technique définit toujours un rapport de l'homme au monde, et la technique moderne, parce qu'elle s'appuie directement sur une science des forces naturelles, apparaîtra d'abord comme libératrice : grâce à ses développements (= le fameux "progrès"), on pense que l'homme pourra en grande partie s'affranchir des contraintes naturelles. Mais ce faisant, on n'aperçoit pas bien les changements profonds que cet affranchissement opère sur l'homme : or ces changements sont tels qu'il est légitime de se demander si la raison technicienne a toujours raison... Le développement technique, en effet, ne peut-il pas contrarier la vie éthique ? Vous pourriez peut-être commencer en rappelant la première partie du mythe de Prométhée raconté par Platon dans son Protagoras : la technique est indéniablement utile dans la mesure où elle répond à un besoin humain profond. Plus fortement, Hegel écrit que l'essor de la technique manifeste le besoin de l'homme de se manifester comme conscience de soi en s'opposant au monde donné (= la nature) : la technique n'a pas seulement pour vocation de compenser la faiblesse constitutionnelle de l'homme (comme il est dit dans le mythe de Prométhée), mais aussi de faire advenir l'esprit, ce qui répond bien à une exigence profonde d'ordre éthique. Vous pourriez alors (= deuxième temps) faire état de l' "emballement" de la raison technicienne : rien ne semble pouvoir résister à la technique, qui prétend changer la face du monde (Descartes), et du même coup changer la donne, comme si l'homme changé par la technique n'était plus vraiment l'homme, comme si la technique pouvait et même devait tout régenter, y compris l'homme lui-même. Dès le début du XIXe siècle, on imagine même qu'il sera possible de créer la vie, de façonner des hommes (Frankenstein)... La technique semble capable de "faire des miracles" : elle semble en effet capable de tout - non seulement d'inventer toutes ces "commodités de la vie", comme dit Platon, mais aussi de changer totalement les moeurs en produisant de nouveaux besoins et de nouvelles conditions de vie, au point de réinventer l'homme lui-même. De simple moyen de production d'une vie plus confortable, la technique est ainsi devenue un véritable mode de pensée : tout problème doit pouvoir recevoir une solution technique. Pourtant (= troisième temps) tout ce qui est possible (techniquement) est-il légitime (éthiquement) ? La technique, en effet, en "arraisonnant" la nature (Heidegger), traite tout en objets. Or l'homme est sujet : c'est même le principe éthique fondamental, puisqu'il n'y a d'éthique que par la considération du sujet moral, c'est-à-dire de la personne. La technique est par essence une activité réductrice : elle tend en effet à réduire la nature à la fonctionnalité de la matière, le citoyen à l'administré, le désir au besoin, la pensée au raisonnement. Et en fournissant des moyens pour tout, la froide raison technique montre qu'elle n'est qu'instrumentale / opératoire. Pourtant, le problème est moins de savoir quels moyens techniques il est possible de mettre en oeuvre que de déterminer à quelles fins ils doivent servir. Or, de ce point de vue, la technique est impuissante : aucune technique, aussi raffinée soit-elle, ne peut déterminer pour nous (= à notre place) ce que nous avons à être et à faire. C'est que la technique ne peut se penser elle-même. L'ingénierie n'est pas tout le génie humain, et les changements induits par la technique ne peuvent donc pas nous dispenser de penser. Le mythe de Prométhée nous avait pourtant averti déjà : l'homme ne possède pas la science politique et ne sait pas se gouverner lui-même, et aucune technique ne peut suppléer à ce manque. Bon courage pour la suite, et donnez des nouvelles. Avec mes... |
|
-: Amitiés :- P h i l i a.
Référence du message : ID 049
Moteur actif : Cléphi![]() changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide
changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide