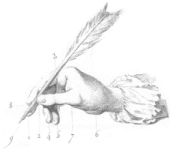Moteur actif Cléphi | courrier - contacter - Philia - |
|
Vous êtes ici : |
La messagerie de Philia édition originale 16-03-2003 actualisée le 12-05-2008 |
|
01/05/2005 |
|
|
|
De Chateaubriand, encore, le 01/05/05 : "Bonjour ! S'engager, est-ce perdre ou affirmer sa liberté ? C'est le sujet sur lequel j'ai déjà réfléchi mais à propos duquel je souhaiterais avoir votre avis, si vous avez le temps de me répondre. |
|
=> 05/05/05 : Rebonjour ô noble Chateaubriand. Très beau sujet que celui que vous avez à traiter. En effet (problématique) : l'engagement, en un sens, paraît manifester notre liberté, puisque rien, en apparence, ne semble nous contraindre à nous engager pour telle ou telle cause. C'est nous qui choisissons de nous engager. On ne dira pas d'un individu qu'on enrôle de force qu'il s'engage. Cela correspond bien à votre partie I. Cependant, nous engager pour une cause n'implique-t-il pas une sorte de contrat qui nous lie à ceux qui soutiennent la même cause, dans les actes comme dans les idées, et ce lien n'est-il pas de nature à nous faire perdre notre liberté ? Et cela correspond bien à votre partie II. Il faut remarquer, à ce stade, que l'opposition I / II peut être superposée à l'opposition individu / société ou individu / groupe : l'engagement est personnel, "donc" libre (I) ; mais il m'engage à contracter avec un groupe, "donc" il restreint ma liberté (II). Pour trouver une 3e partie, il faut donc à la fois revisiter l'idée de liberté, et critiquer la prétendue opposition entre l'individu et la société. Or la liberté semble pensée de la même façon en I et en II : elle résulte du choix individuel. Voilà pourquoi, en I, je puis me prétendre libre : en effet, c'est moi qui m'engage, sans y être contraint. Mais voilà aussi pourquoi, en II, on peut dire que notre liberté diminue, dans la mesure où l'engagement nous lie à d'autres, ce qui entraîne inévitablement des "concessions", voire des renoncements. Mais justement : ce présupposé - commun à I et à II - est-il tenable ? A-t-on raison de penser que la liberté est le fait de l'individu doté d'une faculté propre de choisir (= le libre arbitre) ? C'est le sens, si je compends bien, de votre partie III : mes actes m'engagent, mais engagent aussi "l'humanité entière", dans la mesure où l'homme (= l'individu existant), en agissant, contribue à définir l'homme (= l'essence de l'homme) : "l'existence précède l'essence". La liberté des individus engage donc celle de l'humanité tout entière ; il n'y a pas de rupture ou d'opposition entre l'individu et le groupe. Votre plan me paraît donc tout à fait valable. Cela paraît très prometteur. Un petit reproche, toutefois : la fin de votre III, à partir de "de plus" : n'est-il pas possible d'améliorer ce lien entre l'idée que l'engagement engage l'humanité autant qu'elle m'engage et l'idée que l'homme est "condamné à être libre" ? => Une piste : en I et II, on présuppose que la liberté n'implique strictement que l'individu - qui s'engage ou s'abstient de s'engager. Or, s'abstenir de s'engager, n'est-ce pas encore s'engager ? Refuser de choisir, n'est-ce pas encore choisir ? Nous sommes condamnés à être libre, parce que nous sommes condamnés à choisir, même si notre choix est de ne pas choisir. Dire que l'homme est "condamné à être libre", c'est donc affirmer qu'il n'est pas possible de se soustraire à l'engagement, puisque choisir (ceci plutôt que cela), c'est toujours s'engager. Selon Sartre, en effet, l'homme est libre, qu'il le veuille ou non. La question n'est donc pas de savoir si l'on doit s'engager ou non, puisque tout existant est inévitablement engagé. Pensez à l'attitude des populations occupées : il est évident que les résistants sont des gens engagés ; mais aussi les collaborateurs, bien que dans le camp opposé. Mais de ceux qui ne sont ni résistants ni collaborateurs (souvent la grande majorité), peut-on dire qu'il sont plus libres ou moins libres que les résistants et les collaborateurs ? Non : ils se sont tacitement engagés, eux aussi, et ce choix est encore à attribuer à la liberté. Pensez à la célèbre formule de Sartre : "Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation". Lorsqu'il écrit "Nous", il veut dire nous tous, sans exemption, car l'engagement n'est pas "optionnel". Bon courage pour la suite. Avec mes... |
|
-: Amitiés :- P h i l i a.
Référence du message : ID 064
Moteur actif : Cléphi![]() changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide
changer le moteur => Cléphi | Zoom | X-Recherche | aide